Les
mirages sont des phénomènes
d'optique dus à la réfraction
de la lumière. Pour comprendre
les mirages, il faut tout d'abord comprendre
le principe de la propagation rectiligne
de la lumière, selon les lois
de R. Descartes sur la réfraction
et la réflexion et la caractérisation
des milieux optiques. Un milieu optique
est caractérisé par un
indice, dit " indice de réfraction
" qui "mesure" la vitesse
de la lumière dans ce milieu
(n = c/v : n, indice du milieu ; c,
célérité de la
lumière dans le vide soit 299
792 458m/s ; v, vitesse de la lumière
dans le milieu considéré).
Donc plus cet indice est élevé,
plus la lumière se propage lentement
dans ce milieu. L'indice de réfraction
de l'air dépend de sa densité
et donc de sa température. Plus
la densité ou la température
est élevée et plus l'indice
est faible et donc plus la lumière
est rapide dans ce milieu. Les lois
fondamentales de l'optique ne sont valables
que dans un milieu homogène dans
lequel l'indice de réfraction
est le même partout.
Les
mirages ont une explication simple :
la lumière suit une trajectoire
courbe. Pourtant les rayons lumineux
se déplacent en ligne droite,
mais la lumière ne suit une trajectoire
rectiligne que dans un milieu homogène,
transparent et isotrope c'est-à-dire
dans un milieu d'indice constant. Dans
l'air, la température n'est pas
constante, entre la température
près du sol et celle à
un mètre de hauteur il peut y
avoir une différence de 10 °C.
Or, chaque couche d'air de température
donnée représente un milieu
spécifique ; et chaque milieu
(d'optique) est caractérisé
par un indice [dit indice de réfraction
qui " mesure " la vitesse
de la lumière dans ce milieu].
Ainsi, lorsque la lumière passe
d'une couche à une autre, c'est-à-dire
d'un milieu d'optique à un autre,
donc d'un milieu physique à un
autre (ayant des propriétés
différentes), les rayons lumineux
changent de comportement et leur trajectoire
en est affectée : changement
de direction, changement de vitesse,
réfraction, diffusion. Donc quand
un rayon lumineux passe d'une couche
à l'autre, il change de direction
ce qui va avoir pour effet de grossir
voir même de "retourner"
l'image envoyée par ces rayons.
Donc ce sont les variations locales
ou globales de température et
de pression dans l'atmosphère
qui engendrent les mirages. L'origine
de ces variations de température,
proche du sol, est un inversement de
température en altitude ou un
réchauffement au ras du sol ou
de la mer. On obtient des images inversées,
on parle alors de réfraction
de la lumière au contact d'un
air plus chaud. Quand les rayons lumineux
provenant d'un objet s'incurvent vers
le haut (le sol est chaud), c'est un
mirage inférieur ; et quand les
rayons lumineux s'incurvent vers le
bas (le sol est froid), on obtient un
mirage supérieur.
Revenons
au aux principes fondamentaux du mirage
:
Si
un rayon passe d'un milieu 1 avec un
angle d'incidence i1 à un milieu
2, avec un angle de réfraction
i2, alors:
SINi1/SINi2 = C1/C2 = N2/N1
C1 = vitesse de propagation de la lumière
dans le milieu 1
C2 = vitesse de propagation de la lumière
dans le milieu 2
N1 = Donnée en fonction du milieu
n1 qui dépend de la longueur
d’onde de la lumière
N2 = Donnée en fonction du milieu
n2 qui dépend de la longueur
d’onde de la lumière
Par définition, pour le vide
n=1 neau=1.00027 et nair=1.33, dans
les conditions normales de températures
et de pression.
L'indice de réfraction est proportionnel
à la densité de l'air,
et donc inversement proportionnel à
la température.
Deux principaux cas :
1er cas où n2>n1, le milieu
2 est plus réfringent que le
milieu 1 et le rayon se rapproche de
la normale.
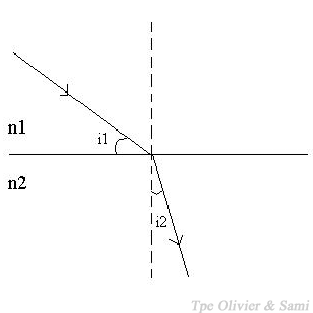
2nd
cas où n1>n2, le milieu 2
est moins réfringent que le milieu
1 et le rayon s'écarte de la
normale.

Nous
allons donc vous expliquer et illustrer
les principaux mirages, et tenter de
vous en expliquer la cause.